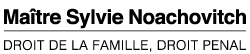Questions / réponses sur le devoir d’information du professionnel de santé
Question : Qu’est ce que le devoir d’information ?
Réponse : Le célèbre arrêt de la cour de cassation Mercier (Civ, 1, 20 mai 1936) vient poser les jalons de la relation patient-praticien. La jurisprudence considère en effet qu’il existe une relation contractuelle entre le patient et son soignant. Une relation de confiance doit donc s’installer et le patient doit pouvoir être pleinement en mesure de consentir ou de refuser les actes thérapeutiques. Le patient ne peut valablement consentir aux soins si ce dernier n’a pas été mis en mesure de pouvoir les comprendre et prendre la pleine dimension de ce qu’ils supposent pour lui.
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative » aux droits malades et à la qualité du système de santé « , le législateur met à la charge du professionnel de santé une obligation d’information du patient. En effet, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose désormais que : « Toute personne a le droit d’être informé sur son état ».
Désormais, l’article R4127-35 du code de la Santé publique dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
Le devoir d’information est à la fois une obligation légale puisqu’il est repris par le code de la santé publique et déontologique puisque l’ensemble des codes de déontologie y font référence.
Question : Quels professionnels sont concernés ?
Réponse : Cette loi s’impose à toutes les professions de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des règles professionnelles qui leur sont applicables. Ainsi, les médecins (Article R. 4127-35 du CSP), les dentistes (R. 4127-233 du CSP), les pharmaciens (R. 4235-2 du CSP), les sages-femmes (Article R. 4127-331 du CSP), les vétérinaires (R. 242-48), les kinésithérapeutes (Art R. 4321-83 du CSP), les infirmières (R. 4312-13 CSP) sont soumis à cette obligations.
Question : Quelles sont les caractéristiques de l’information délivrée ?
Réponse : Le patient doit être informé de l’évolution de sa pathologie, de la nature des soins prodigués et des risques qu’ils supposent.
L’information doit revêtir plusieurs caractéristiques. Elle doit être claire et appropriée au patient (Article R. 4127-35 CSP), mais également loyale et complète. Pour donner son consentement, le patient doit pouvoir être mis en capacité de comprendre les informations délivrées. Elles doivent donc être adaptées en considération de l’âge du patient, de ses capacités intellectuelles ou encore de ses connaissances en la matière. Par exemple, un patient médecin sera plus enclin à comprendre les termes médicaux qu’un patient profane, néanmoins les connaissances médicales du patient ne doivent pas dispenser le praticien de son obligation (voir en ce sens, CE, 22 décembre 2017).
Question : Les risques exceptionnels doivent ils eux aussi faire l’objet d’une information ?
Réponse : Absolument. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que l’information médicale délivrée doit contenir également les risques graves prévisibles et exceptionnels à partir du moment où ce risque était scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé (voir notamment Cass, Civ,1ère, 12 octobre 2016 n°15-16.894).
Attention, depuis un arrêt CE, 19 octobre 2016, la jurisprudence tend à retenir une solution plus nuancée (et plus pragmatique), en consacrant la notion de « manque d’information » lorsque le praticien n’a que partiellement manqué à son devoir d’information. Ainsi, les juges analyseront in concreto le manquement au regard du caractère exceptionnel du risque non averti. Il est donc essentiel pour le praticien, comme pour la victime, d’être assisté d’un avocat.
Question : Y a-t-il des exceptions légales au devoir d’information ?
Réponse : Il existe deux exceptions au devoir d’information du patient fixées par l’article L. 1111-2 du CSP :
– la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic ou de son pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à des risques de transmission (exemple du VIH).
– en cas de circonstances exceptionnelles d’urgence ou d’impossibilité du fait de son état de santé.
Question : A qui incombe la charge de la preuve de délivrance ?
Réponse : Rapporter la preuve d’un manquement d’information serait trop difficile pour un patient. Le patient n’a pas à rapporter la preuve du manquement au devoir d’information en tant que tel. Néanmoins, il devra justifier de ses préjudices pour se faire indemniser et il devra déposer plainte auprès du conseil de l’Ordre auquel appartient le praticien.
En conséquence, -et dans une logique indemnitaire-, la charge de la preuve incombera au praticien, qui peut le faire par tout moyen (Article L. 1111-2 du Code de la santé publique, Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).
Ce dernier devra veiller à se pré-constituer des preuves en amont pour se prémunir d’une quelconque action en responsabilité puisque ce sera à lui de rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information médicale.
Question : Quelles sanctions encourues en cas de manquement ?
Réponse : En plus de subir une procédure d’indemnisation devant les juridictions civiles (ou administratives, selon le caractère public ou privé du professionnel), le praticien engagera sa responsabilité sur le plan ordinal. En effet, si le patient dépose une plainte auprès du conseil de l’ordre, une sanction ordinale pourra lui être infligée allant du simple avertissement jusqu’à la radiation (rare).
Question : Quels préjudices invoquer en cas de manquement au devoir d’information ?
Réponse : En cas de contestation relative à l’obligation d’information, il reviendra au praticien « d’apporter la preuve par tous moyens de son exécution, notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du Code civil » (Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).
Dans un arrêt en date du 3 juin 2016, la cour de cassation a rappelé que le seul fait d’avoir manqué à son obligation d’information était susceptible d’ouvrir droit à indemnisation car ce manquement cause nécessairement un préjudice :
– le préjudice de « perte de chance » : c’est l’impossibilité pour le patient d’avoir pu refuser le traitement ou d’en accepter un autre du fait du manque d’informations. Ce préjudice découle automatiquement du manquement au devoir d’information et est systématiquement réparable.
– le préjudice moral « d’impréparation » : lorsque le patient n’a pas pu se préparer moralement aux risques qu’il encourrait parce qu’il pensait l’opération bénigne. Ce préjudice est souvent invoqué dans le cadre de soins vétérinaires pour le propriétaire de l’animal décédé.
Question : Comment le praticien peut-il rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information ?
Réponse : L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que l’information doit être délivrée via un entretien individuel et oral. La preuve étant à rapporter « par tout moyen », il n’y a pas de hiérarchie dans les types de preuve : le tout est d’établir un faisceau de présomptions suffisant pour se disculper. Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne suffira pas de délivrer un écrit détaillé sur les risques de telle ou telle intervention : la remise d’un écrit ne viendra que compléter l’information délivrée oralement.
La preuve étant particulièrement difficile à rapporter, le professionnel de santé doit veiller à toujours de préconstituer des preuves de cette délivrance d’information. Par exemple, il peut annexer au dossier médical du patient une note relative aux informations délivrées pendant l’entretien oral. Il peut également se faire accompagner d’un assistant pendant la délivrance de l’information, ou faire signer au patient une attestation de délivrance d’information. Attention, tous les modes de la preuve ne sont pas admissibles dans la mesure où ces derniers auraient pour conséquence de rompre le secret médical.
Question : Qu’est-ce que le contrat de soins ?
Réponse : Le contrat de soin peut venir formaliser contractuellement le consentement du patient à l’intervention chirurgicale. Il est souvent utilisé chez les vétérinaires (et encouragé par l’Ordre national des Vétérinaires) pour s’assurer que le propriétaire de l’animal consente effectivement aux interventions pratiquées. Le professionnel en profitera pour relater l’état antérieur du patient et préciser l’étendue de son mandat. Le contrat devra être réalisé en deux exemplaires originaux remis à chacune des deux parties.
Formulaire de Contact
Demande de contact
La garantie décennale
Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.
Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.
Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.
Le devis du professionnel doit comporter :
- la date de validité,
- la valeur,
- les activités couvertes,
- la zone géographique de couverture.
La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.
ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.
L'assurance dommages-ouvrage
Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.
Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.
L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.
En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.
Paris
48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80
Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.
Modification de l’introduction de l’instance
Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.
- L’acte introductif d’instance.
Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :
- Par une assignation ;
- Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.
- Le fondement de la demande de divorce.
Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :
- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux
lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :
- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.
Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.
- L’acceptation du principe du divorce.
Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :
- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.
Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.
- Le divorce pour faute.
Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.
Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.
- La saisine de la juridiction.
Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.
En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.
Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.
Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.
L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.
En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :
- Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
- La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
- Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
- L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.
48 bd Émile Augier
Enghien-les-Bains
12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80
Cabinet 2
Retrouvez les interventions de Maître Noachovitch dans l'émission Arnaques ! diffusée le 29 mai 2025 sur M6. Cette émission évoque les arnaques qui se déroulent dans les foires et maître Sylvie Noachovitch donne tous les bons conseils pour ne plus se faire avoir, tout en décryptant les différentes arnaques.
Pour nous appeler :
Questions / réponses sur le devoir d’information du professionnel de santé
Question : Qu’est ce que le devoir d’information ?
Réponse : Le célèbre arrêt de la cour de cassation Mercier (Civ, 1, 20 mai 1936) vient poser les jalons de la relation patient-praticien. La jurisprudence considère en effet qu’il existe une relation contractuelle entre le patient et son soignant. Une relation de confiance doit donc s’installer et le patient doit pouvoir être pleinement en mesure de consentir ou de refuser les actes thérapeutiques. Le patient ne peut valablement consentir aux soins si ce dernier n’a pas été mis en mesure de pouvoir les comprendre et prendre la pleine dimension de ce qu’ils supposent pour lui.
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative » aux droits malades et à la qualité du système de santé « , le législateur met à la charge du professionnel de santé une obligation d’information du patient. En effet, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose désormais que : « Toute personne a le droit d’être informé sur son état ».
Désormais, l’article R4127-35 du code de la Santé publique dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
Le devoir d’information est à la fois une obligation légale puisqu’il est repris par le code de la santé publique et déontologique puisque l’ensemble des codes de déontologie y font référence.
Question : Quels professionnels sont concernés ?
Réponse : Cette loi s’impose à toutes les professions de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des règles professionnelles qui leur sont applicables. Ainsi, les médecins (Article R. 4127-35 du CSP), les dentistes (R. 4127-233 du CSP), les pharmaciens (R. 4235-2 du CSP), les sages-femmes (Article R. 4127-331 du CSP), les vétérinaires (R. 242-48), les kinésithérapeutes (Art R. 4321-83 du CSP), les infirmières (R. 4312-13 CSP) sont soumis à cette obligations.
Question : Quelles sont les caractéristiques de l’information délivrée ?
Réponse : Le patient doit être informé de l’évolution de sa pathologie, de la nature des soins prodigués et des risques qu’ils supposent.
L’information doit revêtir plusieurs caractéristiques. Elle doit être claire et appropriée au patient (Article R. 4127-35 CSP), mais également loyale et complète. Pour donner son consentement, le patient doit pouvoir être mis en capacité de comprendre les informations délivrées. Elles doivent donc être adaptées en considération de l’âge du patient, de ses capacités intellectuelles ou encore de ses connaissances en la matière. Par exemple, un patient médecin sera plus enclin à comprendre les termes médicaux qu’un patient profane, néanmoins les connaissances médicales du patient ne doivent pas dispenser le praticien de son obligation (voir en ce sens, CE, 22 décembre 2017).
Question : Les risques exceptionnels doivent ils eux aussi faire l’objet d’une information ?
Réponse : Absolument. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que l’information médicale délivrée doit contenir également les risques graves prévisibles et exceptionnels à partir du moment où ce risque était scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé (voir notamment Cass, Civ,1ère, 12 octobre 2016 n°15-16.894).
Attention, depuis un arrêt CE, 19 octobre 2016, la jurisprudence tend à retenir une solution plus nuancée (et plus pragmatique), en consacrant la notion de « manque d’information » lorsque le praticien n’a que partiellement manqué à son devoir d’information. Ainsi, les juges analyseront in concreto le manquement au regard du caractère exceptionnel du risque non averti. Il est donc essentiel pour le praticien, comme pour la victime, d’être assisté d’un avocat.
Question : Y a-t-il des exceptions légales au devoir d’information ?
Réponse : Il existe deux exceptions au devoir d’information du patient fixées par l’article L. 1111-2 du CSP :
– la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic ou de son pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à des risques de transmission (exemple du VIH).
– en cas de circonstances exceptionnelles d’urgence ou d’impossibilité du fait de son état de santé.
Question : A qui incombe la charge de la preuve de délivrance ?
Réponse : Rapporter la preuve d’un manquement d’information serait trop difficile pour un patient. Le patient n’a pas à rapporter la preuve du manquement au devoir d’information en tant que tel. Néanmoins, il devra justifier de ses préjudices pour se faire indemniser et il devra déposer plainte auprès du conseil de l’Ordre auquel appartient le praticien.
En conséquence, -et dans une logique indemnitaire-, la charge de la preuve incombera au praticien, qui peut le faire par tout moyen (Article L. 1111-2 du Code de la santé publique, Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).
Ce dernier devra veiller à se pré-constituer des preuves en amont pour se prémunir d’une quelconque action en responsabilité puisque ce sera à lui de rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information médicale.
Question : Quelles sanctions encourues en cas de manquement ?
Réponse : En plus de subir une procédure d’indemnisation devant les juridictions civiles (ou administratives, selon le caractère public ou privé du professionnel), le praticien engagera sa responsabilité sur le plan ordinal. En effet, si le patient dépose une plainte auprès du conseil de l’ordre, une sanction ordinale pourra lui être infligée allant du simple avertissement jusqu’à la radiation (rare).
Question : Quels préjudices invoquer en cas de manquement au devoir d’information ?
Réponse : En cas de contestation relative à l’obligation d’information, il reviendra au praticien « d’apporter la preuve par tous moyens de son exécution, notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du Code civil » (Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. n° 278).
Dans un arrêt en date du 3 juin 2016, la cour de cassation a rappelé que le seul fait d’avoir manqué à son obligation d’information était susceptible d’ouvrir droit à indemnisation car ce manquement cause nécessairement un préjudice :
– le préjudice de « perte de chance » : c’est l’impossibilité pour le patient d’avoir pu refuser le traitement ou d’en accepter un autre du fait du manque d’informations. Ce préjudice découle automatiquement du manquement au devoir d’information et est systématiquement réparable.
– le préjudice moral « d’impréparation » : lorsque le patient n’a pas pu se préparer moralement aux risques qu’il encourrait parce qu’il pensait l’opération bénigne. Ce préjudice est souvent invoqué dans le cadre de soins vétérinaires pour le propriétaire de l’animal décédé.
Question : Comment le praticien peut-il rapporter la preuve de la bonne délivrance de l’information ?
Réponse : L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que l’information doit être délivrée via un entretien individuel et oral. La preuve étant à rapporter « par tout moyen », il n’y a pas de hiérarchie dans les types de preuve : le tout est d’établir un faisceau de présomptions suffisant pour se disculper. Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne suffira pas de délivrer un écrit détaillé sur les risques de telle ou telle intervention : la remise d’un écrit ne viendra que compléter l’information délivrée oralement.
La preuve étant particulièrement difficile à rapporter, le professionnel de santé doit veiller à toujours de préconstituer des preuves de cette délivrance d’information. Par exemple, il peut annexer au dossier médical du patient une note relative aux informations délivrées pendant l’entretien oral. Il peut également se faire accompagner d’un assistant pendant la délivrance de l’information, ou faire signer au patient une attestation de délivrance d’information. Attention, tous les modes de la preuve ne sont pas admissibles dans la mesure où ces derniers auraient pour conséquence de rompre le secret médical.
Question : Qu’est-ce que le contrat de soins ?
Réponse : Le contrat de soin peut venir formaliser contractuellement le consentement du patient à l’intervention chirurgicale. Il est souvent utilisé chez les vétérinaires (et encouragé par l’Ordre national des Vétérinaires) pour s’assurer que le propriétaire de l’animal consente effectivement aux interventions pratiquées. Le professionnel en profitera pour relater l’état antérieur du patient et préciser l’étendue de son mandat. Le contrat devra être réalisé en deux exemplaires originaux remis à chacune des deux parties.
Pour nous appeler :



Formulaire de Contact
Paris
48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80
Enghien-les-Bains
12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien les Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80